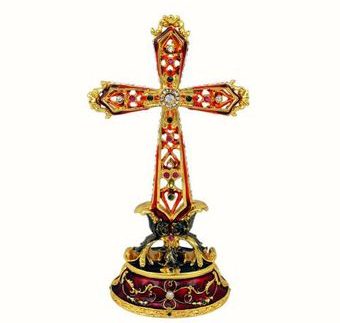ou Comment aider les fidèles à faire ce chemin spirituel et à recevoir le sacrement
(exposé introductif pour la réunion annuelle du clergé, en septembre 2006)
-2ème éd. revue et augmentée, en 2010-
(Téléchargez la version PDF en cliquant ici)
-Quelques rappels
Paenitentia est un terme latin qui signifie regret, repentir ; il a servi à traduire le terme grec metanoïa, dans lequel on trouve, en plus, les notions importantes de changement, de conversion.
La pénitence c’est se mettre devant Dieu, confesser son péché, le regretter profondément et demander pardon à Dieu.
Le péché n’est pas de nature morale mais spirituelle : c’est un comportement spirituel inexact, dévié. Tout péché est un péché contre Dieu. La pénitence est le retour à Dieu.
Le modèle évangélique de la pénitence et du retour à Dieu, c’est l’Enfant prodigue. Il faut relire attentivement cette parabole, pour s’imprégner de l’esprit du repentir.
– L’importance capitale de la pénitence
Sans le repentir, rien n’est possible : la vie ne sert à rien, la religion ne sert à rien.
La pénitence c’est la porte étroite de l’Evangile. Elle est l’unique porte : il n’y en a pas d’autre. Dieu ne fait pas les questions et les réponses et Il n’impose ni le salut, ni le bonheur. L’homme a librement péché contre Dieu. Et c’est librement, de lui-même, qu’il doit revenir à Dieu.
Le 1er péché de l’homme a été la désobéissance, qui était en fait un manque de confiance en Dieu et d’amour de Dieu. Mais le deuxième péché est aussi grave (et selon certains pères plus grave) c’est le refus du repentir. Lorsque Dieu vient le soir dans le Jardin d’Eden et qu’Il découvre Adam et Eve se cachant, chacun rejette la faute sur l’autre. Adam : « c’est la femme. » (avec une mauvaise foi totale : « la femme que tu as placée près de moi… » !) Eve : « c’est le serpent. » Alors c’est qui ? On s’attend presque à entendre le Serpent dire : c’est Dieu. Ni Adam, ni Eve ne se repentent. Au lieu de s’accuser eux-mêmes avec humilité, ils accusent « l’autre ». Plusieurs pères disent que si Adam et Eve s’étaient repentis, tout restait possible.
La pénitence, c’est l’inverse. Elle consiste à dire : « c’est moi », c’est moi qui suis fautif, et je le regrette amèrement. La pénitence est le bain de jouvence de l’âme, le renouvellement du cœur, le baptême des larmes. Nous devons marteler cela à nos fidèles.
– Le détournement historique de l’esprit et du contenu de la pénitence par les hommes d’Eglise et par les décadences de l’Eglise.
Il y a 3 défauts graves qui, dans le cours de l’histoire, ont nui à la pratique de la pénitence :
- La vision morale du péché et de la pénitence, qui ont amoindri et voilé la réalité qui est d’ordre spirituel. Le péché est une déficience d’amour, de ressemblance à Dieu: il n’est pas d’ordre moral, mais d’ordre spirituel. Les seules personnes à qui le Christ ait prédit la mort éternelle étaient des gens « biens », très bien même, moralement et « religieusement » : c’étaient les Scribes et les Pharisiens.
- La volonté de contrôle des consciences par le clergé, qui est une volonté de puissance et qui a produit des millions d’athées.
- La vision « culturelle » de la vie chrétienne, que les églises ont acquise au fil du temps et qui prend la place de l’expérience spirituelle. Elle se manifeste par les habitudes et par le formalisme: ce sont les choses qu’on « doit faire » (jeûner, se confesser,…) en oubliant leur finalité. Par exemple, chez les Musulmans ou les Juifs :« je ne suis pas pratiquant, mais je ne mange pas de porc » ; ou encore chez les Catholiques-romains, ceux qui ne mangeaient pas de viande le vendredi,mais qui n’allaient jamais à la messe. On garde l’usage extérieur, mais on en oublie le sens et la finalité. On peut mentionner aussi l’excès des rites préparatoires, en Orient comme en Occident, qui finit par empêcher les fidèles d’accéder aux sacrements (par exemple les longs jeûnes et la confession obligatoire pour pouvoir communier) : la préparation devient plus importante que l’accomplissement !
Comme illustration : une expérience personnelle.
Je me suis confessé pendant 15 ans, à peu près une fois par semaine, dans l’Eglise catholique-romaine parce qu’il « fallait le faire », et que j’étais pieux. C’était une obligation : j’obéissais. Je débitais mes péchés d’une façon formelle, convenue, devant quelqu’un qu’on ne voyait pas (caché dans le « confessionnal ») et qui à la fin disait une formule en latin, à laquelle on ne comprenait pas grand-chose. Et il y avait un « tarif », toujours le même : dire 3 Notre- Père et 3 Je-vous-salue-Marie.
La première fois où je suis venu dans une église orthodoxe, à la cathédrale Saint-Irénée, j’ai vu l’Evêque Jean faire une « confession générale », en public,devant les portes royales ( c’était les Quatre-temps d’automne). Lorsque j’ai vu ce vénérable évêque, qui était un grand spirituel, confesser ses péchés devant tout le peuple, avec sobriété et exactitude, j’ai été saisi, ébranlé : j’ai subitement compris le sens du terme « repentir ». Et lorsqu’il a donné l’absolution générale ( «… moi évêque successeur des Apôtres, malgré mon indignité, je vous délie et je vous absous de tous vos péchés… »), j’ai compris le sens du « pouvoir de lier et de délier ». C’était la première fois de ma vie que je comprenais réellement ce qu’était la pénitence. J’avais 20 ans. On n’était plus dans le formel, mais dans le spirituel, on était dans l’esprit du repentir.
– Les étapes : le processus de la pénitence
Nous allons essayer de voir, à chaque étape, comment, nous les prêtres, nous pouvons aider les fidèles. On peut distinguer 6 étapes dans le processus de la pénitence :
- La conscience de son péché
On ne peut pas regretter ce dont on n’est pas conscient.
C’est là où la culture religieuse fait le plus de dégâts. Le péché est d’ordre spirituel. Il n’y a pas de barème absolu du bien et du mal. Le péché est uniquement par rapport à Dieu et par rapport à l’amour, car « Dieu est amour ».
Il faut sortir des listes de péchés toutes prêtes, préétablies, des poncifs, des idées toutes faites, des a priori moraux. On peut être très bien moralement et pêcher gravement (cf. les Scribes et les Pharisiens).
Ce n’est pas tel acte, tel comportement, telle pensée qui sont en soi des péchés, mais l’intention profonde qui les sous-tend.
Nous devons amener les fidèles à se dire : qu’est-ce qui, dans ma vie, me fait progresser vers à la ressemblance à Dieu, et qu’est-ce qui me fait régresser vers la dissemblance ? En quoi suis-je agréable à Dieu et en quoi ne lui suis-je pas agréable ?
Il y a beaucoup de fidèles qui s’accusent de péchés qui n’en sont pas, et qui ne voient pas leurs vrais péchés. Il appartient au confesseur de les aider à discerner. Il faut amener les fidèles à réfléchir à l’intention profonde qui était en eux. Il faut aussi regarder les fruits (à court, moyen et long terme). Et enfin il ne faut pas oublier le contexte dans lequel se trouve la personne, qui permet de voir les circonstances atténuantes. Il faut pouvoir apprécier la gravité réelle de l’acte ou du comportement.
- Exemple: les personnes qui viennent et qui n’ont rien à dire parce qu’elles se trouvent « bien » et que leur vie va bien. Elles viennent se confesser formellement parce que c’est l’usage. J’en ai vu beaucoup. Mais souvent elles ne voient pas leur principal péché, qui est grave et qui est l’autosatisfaction, dont Dieu a horreur.
- Autre exemple. : « j’ai eu de mauvaises pensées ». En Occident c’est toujours d’ordre sexuel. Mais le désir sexuel n’a rien de mauvais en soi. Il serait inquiétant que des jeunes gens n’aient pas de désirs sexuels. Ce n’est pas le fait d’avoir des désirs sexuels ou d’avoir une vie sexuelle qui est un péché. Mais il faut se poser la question : j’ai du désir pour quelle personne ? Comment est-ce que je me comporte dans l’accomplissement de ce désir ? Et, par ailleurs, il y a beaucoup de pensées impures qui ne sont pas d’ordre sexuel ou charnel. La véritable impureté est intérieure, une division en nous-même, la perte de notre intégrité.
- La confession de son péché
En avoir conscience est une chose, l’avouer, c’est autre chose. Confesser, c’est reconnaître, c’est l’aveu dans sa culpabilité. Il ne suffit pas de discuter avec son confesseur. Il faut que la personne confesse devant Dieu son péché, avec sobriété, objectivité. C’est un acte libérateur pour la conscience (les psychologues le savent bien), qui est aussi pédagogique pour le pénitent, car c’est une école d’humilité. C’est reconnaître devant une tierce personne – fut-il un prêtre – qu’on n’est « pas bien » ou « pas si bien » et que notre apparence extérieure ne correspond pas à ce qui est dans notre cœur. Cela demande du courage. Cela brise notre amour propre, notre orgueil. Et cela nous apprend à ne pas juger les autres.
Il peut être utile parfois de distinguer la discussion elle-même avec le pénitent (autour d’une table) qui permet le défrichage, l’exploration, de la confession elle-même qui doit être sobre, sans entrer dans les détails inutiles. Toutefois elle doit être quand même suffisamment précise pour qu’il puisse y avoir une prise de conscience de la gravité de l’acte. Le fidèle doit savoir que le prêtre n’est qu’un témoin qui ne porte aucun jugement de valeur. Le discernement qu’il exerce n’est pas un jugement. Là, le prêtre est « l’oreille de Dieu ».
- Le regret de son péché : le repentir
Il ne suffit pas d’avoir conscience de son péché ni de l’avoir avoué : il faut le regretter amèrement, profondément, parfois avec larmes : c’est le repentir. Il est la clé de la pénitence. On entend souvent dire,à notre époque : « je viens déposer telle ou telle chose …». Déposer un fardeau, c’est bien, mais cela ne suffit pas, Le fardeau est surtout pour celui qui a été victime de notre iniquité, de notre méchanceté. Il faut ajouter : « je me repends profondément pour la mal que j’ai fait (ou le bien que je n’ai pas fait) » ! Sans cela, tout le reste n’est que poussière.
Et parfois on peut avoir des doutes. Il y a des fidèles qui expriment leurs péchés sans manifester le moindre repentir. « C’est dit, c’est bon ». Ça suffit. Ils considèrent qu’ils sont en règle. Point.
J’ai demandé un jour conseil à un confrère russe qu’était un bon confesseur, car je ne savais pas que faire. Et il m’a dit : tu peux demander : « est-ce que tu as du repentir ? Est-ce que tu as conscience que ce que tu as fait est grave ? » Et il m’est arrivé plusieurs fois de le dire, même à des prêtres qui venaient se confesser à moi.
Il peut même parfois être utile de demander des preuves du repentir, par exemple lorsque des actes ou des comportements mettent des personnes en danger, et surtout des personnes fragiles, innocentes (comme c’est le cas pour la pédophilie : quelqu’un qui ne voudrait ni se dénoncer, ni se faire soigner n’aurait aucun repentir réel ;et si une personne condamnée pour de tels actes, fait appel, cela signifie qu’elle n’a aucun repentir). Le confesseur ne doit pas oublier le salut des victimes ou des éventuelles victimes.
Il y a dans l’Evangile un bel exemple parabolique de repentir : l’Enfant prodigue, et deux beaux exemples réels, historiques : Marie de Magdala et le Bon larron. Je n’ai pas le temps de les développer, mais je vous invite à les contempler et à les méditer. Ces trois exemples évangéliques sont extrêmement riches d’enseignement, tant pour les pénitents que pour les confesseurs.
C’est la partie la plus importante de la démarche pénitentielle. C’est celle qui brise la dureté de notre cœur.
Ce regret peut durer longtemps : certains pères ont pleuré pendant des années pour de petites fautes. Saint Nectaire d’Egine, qui avait giflé son serviteur pour avoir laissé brûlé le repas, a eu un tel repentir qu’il a demandé à Dieu de le priver pour toujours du goût. Et il a fait cette ascèse tout le restant de sa vie !
- La demande de pardon
Le repentir y conduit naturellement. Mais pour recevoir le pardon il faut le demander. Dieu n’impose pas le salut. Souvent le Christ dit à ceux qui viennent lui demander de l’aide : « que veux-tu ? », ce qui responsabilise les êtres. Ce pardon nous le demandons évidemment à Dieu. Mais nous devons aussi le demander, si cela est possible, à ceux à qui nous avons fait du mal, à ceux que nous avons blessé.
Mais attention : le prochain que j’ai blessé est libre. Il n’est pas obligé de me pardonner. Tant pis : c’est son problème spirituel. Il ne faut pas s’en formaliser. Et par ailleurs, dans certains cas il vaut mieux s’abstenir. Il faut tenir compte du contexte et des personnes. Si on a eu des pensées extrêmement méchantes vis-à-vis d’une personne, il n’est pas nécessairement bon d’aller le lui dire. Cela peut faire plus de mal que de bien. Mais s’il n’est pas toujours utile de faire cette démarche, on peut parfois compenser, réparer, ce qui joue le même rôle.
- La réparation de nos fautes
Il y a beaucoup de cas où ce n’est pas possible. Mais chaque fois que c’est possible il faut le faire. Si j’ai volé, je rends ce que j’ai volé.
Dans certains cas, c’est absolument indispensable, comme par exemple pour la calomnie. Car le mal continue à courir et il peut détruire la personne qui en est victime (lorsqu’il y a un incendie, il faut éteindre le feu tout de suite ; sinon tout peut être détruit). Dans ce cas-là le calomniateur doit parler à tous ceux à qui il a menti pour rétablir la vérité.
Cela peut même parfois conditionner le pardon. Je reviens au cas grave de la pédophilie, qui est un crime : on ne peut pas se contenter d’une simple confession orale. Il faut que la personne s’engage formellement, soit à se denoncer – en acceptant d’être condamnée- , soit à se soigner -et à réparer autant que faire se peut- ; elle doit au moins accepter de se mettre dans une situation où elle ne pourra plus recommencer. Si elle ne le fait pas, c’est qu’elle ne se repent pas et qu’elle veut demeurer dans son péché.
Autre exemple : un proxénète, c’est-à-dire un homme qui réduit des femmes en esclavage. S’il n’arrête pas immédiatement cette activité inhumaine, c’est qu’il n’a aucun repentir.
Le fait de réparer aide aussi à se pardonner à soi-même. C’est un élément important, surtout pour les péchés graves.
- Le changement de comportement
C’est le but ultime de toute la démarche. Si on ne change pas, le pardon reçu ne sera pas fécond, il ne pénètrera pas dans le cœur. Les sacrements ne sont pas magiques. : la grâce ne peut rien sans la volonté libre de l’homme.
Souvent ce changement suppose une certaine ascèse. Il peut être utile pour le prêtre de donner des conseils (parfois fermes) au pénitent. Le but n’est pas de « payer » sa faute, mais de se transformer, de changer. Il y a un autre intérêt : cela nous aide à nous pardonner à nous-même. Lorsqu’on n’est plus le même homme, lorsqu’on a changé, on peut vraiment recevoir le pardon de Dieu dans la profondeur de son être et, enfin, se pardonner soi-même, ce qui est très difficile.
Le sacrement de la pénitence est un trésor spirituel, mais il ne faut pas le galvauder, il ne faut pas l’amoindrir, le vider de son contenu. Nous, les prêtres, les confesseurs, ne devons pas oublier que le pénitent n’est pas seulement un enfant de l’Eglise : il est aussi une personne libre face à Dieu.
Il y a beaucoup d’autres problèmes dont nous pourrons discuter tout à l’heure. Je n’en mentionne qu’un,par manque de temps : passer d’une paroisse à l’autre ou d’une juridiction à l’ autre. C’est une des plaies de l’Orthodoxie. Lorsqu’une personne a commis un péché grave,qui justifierait un éloignement temporaire des sacrements,elle peut trouver plus commode de changer de paroisse ou même de juridiction,car il est plus facile de taire certaines fautes,de se justifier ou de raconter n’importe quoi à un prêtre qui ne vous connaît pas. Cela signifie que, souvent, ces fidèles mentent dans leur confession. On ne peut pas faire grand-chose. On peut simplement se dire que, en fait, ils mentent à Dieu et qu’ils auront à en rendre compte devant Dieu.
Père Noël TANAZACQ
Recteur de la paroisse Ste-Geneviève- St-Martin (Paris)
Cet exposé a été fait lors de la réunion annuelle du clergé de la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, dont le thème était la Pénitence, le 30 septembre 2006, ce qui explique son style parlé, non littéraire, et le fait que certaines notions soient à peine abordées,car elles étaient supposées connues.
L’auteur l’a entièrement revu, corrigé et augmenté le 18 mars 2010 ; et partiellement corr. en mai 2015.